11 septembre 1789
NAISSANCE DE LA DROITE ET DE LA GAUCHE...
HISTOIRE POLITIQUE
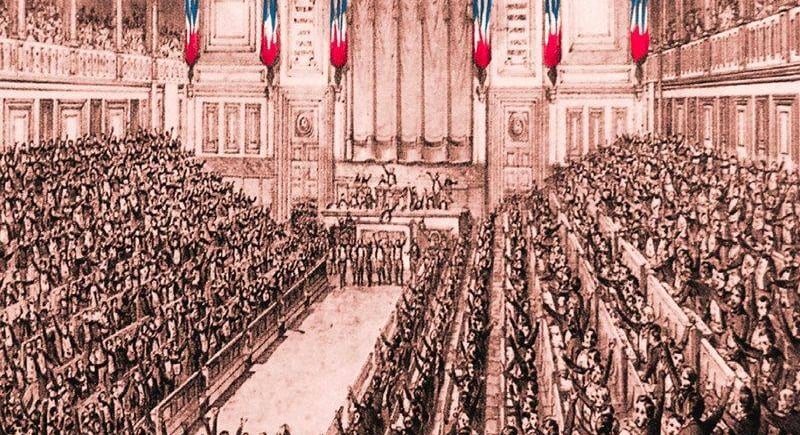
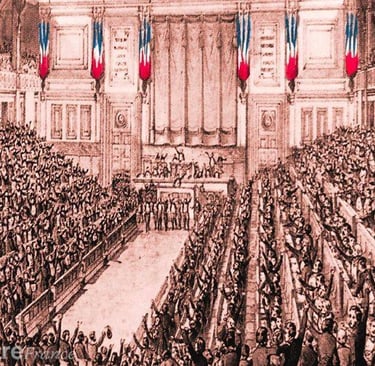
L'Assemblée Nationale en 1789, à Versailles.
D’habitude, lorsqu’on évoque le 11 septembre, on pense immédiatement au sanglant coup d’Etat de Pinochet au Chili en 1973 ou bien sûr aux attentats terroristes de 2001 aux Etats-Unis, notamment à New York et Washington…
Dans un registre moins connu, ce 11 septembre marque également la naissance des concepts de « Droite » et de « Gauche » en politique en 1789 pendant les débats de l’Assemblée nationale constituante, en pleine Révolution française.
Il est bon de rappeler que cette Assemblée discute alors du droit de veto du roi (Louis XVI) en posant les questions suivantes :
Le monarque doit-il avoir un veto absolu (pouvant bloquer définitivement les lois) ou seulement un veto suspensif (pouvant retarder une loi, mais non l’empêcher) ?
Lors de la séance, la disposition dans l’hémicycle se présente de la façon suivante :
À la droite du président de l’Assemblée s’installent ceux qui soutiennent le roi et les partisans de l’ordre établi (clergé, noblesse, monarchiens).
À la gauche du président prennent place ceux qui refusent un pouvoir fort du roi et défendent les réformes (patriotes, futurs « jacobins »).
Cette répartition spatiale a cristallisé les étiquettes :
La droite : conservatrice, attachée à la monarchie, à l’ordre et aux traditions.
La gauche : progressiste, favorable au changement, à la souveraineté du peuple et aux réformes sociales et politiques.
Depuis ce 11 septembre 1789, cette distinction s’est perpétuée dans la vie politique française, puis internationale, même si son contenu a beaucoup évolué avec le temps comme nous pouvons le constater aujourd’hui.
En ce qui concerne la Droite, on a pu voir émerger durant la IIIème République, l’émergence de familles bien distinctes qui se sont affirmées :
Les légitimistes (nostalgiques des Bourbons, catholiques conservateurs),
Les orléanistes (bourgeois libéraux, défenseurs des libertés économiques),
Les bonapartistes (césaristes, attachés à l’autorité de l’État et au prestige national).
Tandis qu’à la fin du XIXème siècle, la droite reste attachée à l’Église, à l’ordre social, à l’armée et à la nation. On a pu constater la montée des droites nationalistes et conservatrices (incarnée par l’influente Action Française et par les Ligues) au lendemain de la Grande Guerre en 1918 et durant toute l’entre-deux-guerres ou l’on constatera une opposition violente au Front Populaire avec ses réformes sociales.
Sous l’Occupation, une partie de la Droite basculera dans la Collaboration avec Vichy tandis que beaucoup d’autres rejoindront la Résistance (il s’agit surtout des Gaullistes et des Démocrates-Chrétiens).
Dans l’immédiate-après-guerre, la IVème République recomposera la Droite en trois familles : la Gaulliste, incarnée par le RPF qui deviendra l’UNR) qui se veut nationaliste et attachée à l’indépendance et au rôle fort de l’Etat, la droite démocrate-chrétienne sous la bannière du MRP et enfin une Droite plus libérale et conservatrice, avec les Indépendants et les Paysans (le CNIP).
1958 marque le retour du Général de Gaulle aux « Affaires » après plus de 12 ans de traversée du désert. L’homme du 18 juin inaugure la Vème République et sa Constitution qui vient de fêter ses 67 ans.
Durant les 23 ans qui vont suivre, on va assister au règne sans partage d’une République Gaullienne puis post-Gaullienne.
Le Gaullisme se veut l’incarnation d’un Etat fort, présidentialiste, héraut de l’Indépendance Nationale tout en prônant une politique sociale d’inspiration Colbertiste.
Après le départ de De Gaulle en 1969, son successeur Georges Pompidou poursuit cette politique, voyant toutefois cette majorité de droite composée des Gaullistes (UDR puis RPR) ainsi que des Libéraux et des Centristes, qui va finir par prendre l’ascendant grâce à l’élection de Valéry Giscard d’Estaing en 1974, qui va d’ailleurs créer une machine de guerre électorale en 1978 : L’UDF qui va combattre son frère ennemi du RPR,
Après la défaite de Giscard en 1981, marquant le grand retour de la Gauche après 23 ans d’absence, la Droite va connaitre les joies de l’alternance politique ainsi que la continuation de ses guerres fratricides.
La Droite est alors pro-européenne, libérale sur l’économie et conservatrice sur la société.
Elu en 2007, Nicolas Sarkozy va incarner une droite décomplexée, sécuritaire et libérale. Le RPR et une grande partie de l’UDF vont fusionner pour créer l’UMP qui se transformera ensuite en LR en2012
Mais cette droite traditionnelle est concurrencée par l’Extrême-droite (L’ex-FN, devenu RN) et par la Droite libéral-progressiste d’Emmanuel Macron qui a « siphonné » une grande partie du Centre-Droit (dont François Bayrou est l’un des leaders).
La Droite parlementaire classique est aujourd’hui affaiblie surtout depuis l’avènement du Macronisme à l’instar de la Gauche, même si le clivage droite-gauche qui fit les beaux jours de la Vème République existe encore et toujours.
La Gauche est donc également apparue en 1789, incarnant alors une volonté de changement, partisane de la souveraineté populaire, de la démocratie et parfois d’une République.
La Gauche révolutionnaire comporte dans ses rangs les Jacobins, les Montagnards ou encore les « sans-culottes » qui défendent l’égalité, le suffrage élargi et les droits sociaux.
Au XIXème siècle, la Gauche libérale et Républicaine va s’allier avec les « socialistes utopiques, les Proudhon, Fourier ou encore Saint-Simon. Sous le second-Empire, elle va clairement afficher son opposition à l’Empereur Napoléon III.
Et plus généralement, sous la IIIème République entre 1870 et 1940, on va assister à une structuration de la Gauche avec la consolidation de la République grâce à la gauche républicaine (Gambetta, Ferry) et surtout la naissance du mouvement ouvrier moderne : syndicats, socialisme, Parti ouvrier français (Guesde), SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière, 1905, Jaurès) et la création du Parti Communiste français en 1920, lors du Congrès de Tours.
Divisions entre radicaux (républicains laïcs, défenseurs de l’école gratuite et obligatoire) et socialistes (question sociale, lutte des classes).
Front populaire (1936, Blum) : grandes avancées sociales (congés payés, semaine de 40h).
Après 1945, la Gauche se compose de la SFIO et du Parti communiste français (PCF), très influent dans les années d’après-guerre. C’est l’époque des grandes conquêtes sociales : Sécurité sociale, nationalisations, droits syndicaux, etc… La Gauche va participer à la plupart des gouvernements de la IVème République avant de connaitre une très (longue) cure d’opposition sous la Vème République
Pourtant les Années 1960-1970 : vont voir l’émergence du Parti socialiste (PS) (1969, refondé en 1971 lors du congrès d’Épinay par François Mitterrand qui prend le leadership de la Gauche jusqu’alors tenu par le Parti Communiste depuis la Libération.
En 1972, une Union de la Gauche (entre PS, PC et Radicaux de Gauche) est créée pour lancer une nouvelle dynamique électorale avec le « Programme Commun » co-signé avec Georges Marchais, Robert Fabre et lors de la Présidentielle anticipée de 1974, François Mitterrand échoue de peu face à Valéry Giscard d’Estaing (qui a obtenu 50.8 % des suffrages exprimés)
Le nouveau PS et son allié Communiste « percent » cependant lors d’élections intermédiaires entre 1973 et 1976, s’emparant de nombreuses villes moyennes et importantes lors des municipales de 1977 ( dont Brest, Montpellier, Rennes, Angers, Créteil, Reims, Saint Etienne, etc…) mais échoue de justesse lors des législatives de 1978 face à la coalition RPR-UDF.
Il faudra attendre le 10 mai 1981 et la victoire de François Mitterrand pour enfin provoquer une alternance historique.
Certains supporters n’hésitent pas à faire un parallèle avec 1789 et la fin de « l’Ancien Régime » « Le 10 mai, les Français ont franchi la frontière qui sépare la nuit de la lumière. » aurait déclaré alors le futur ministre de la Culture, Jack Lang.
Dans la foulée, le nouveau locataire de l’Elysée dissout l’Assemblée nationale et les élections à venir vont se transformer en véritable « Vague rose » : le seul Parti Socialiste ne remporte pas moins de 266 sièges et l’ensemble de la Gauche (PC, PS, MRG, Divers Gauche) totaliseront 333 sièges sur les 491 de l’Assemblée Nationale. Pierre Mauroy, maire de Lille devient le premier chef de gouvernement du premier Septennat Mitterrand, tandis que Louis Mermaz s’assoit au perchoir du Palais-Bourbon.
La nomination de 4 ministres Communistes au sein du nouveau gouvernement ne va pas passer inaperçu, y compris à l’Etranger. Le vice-président Américain George Bush va même être reçu à l’Elysée pour exprimer l’inquiétude des USA quant à ces nominations.
La Gauche au pouvoir est prise d’une grande fièvre réformiste : avec l’abolition de la peine de mort, les 39h, la retraite à 60 ans, la fin du monopole des ondes, les Nationalisations, etc….
Mais deux ans après, l’euphorie est tombée et le rude exercice du pouvoir impose le « tournant de la rigueur ». Pierre Mauroy sera bientôt remplacé par Laurent Fabius, alors le plus jeune chef de gouvernement de la Vème République. Lucide mais cynique, François Mitterrand afin d’éviter une déroute électorale de la Gauche en 1986 impose le scrutin à la proportionnelle qui n’empêchera pas la victoire de la coalition RPR UDF mais de façon étriquée, permettant également au Front National d’envoyer 35 députés à l’Assemblée Nationale et enfin de créer la première « Cohabitation » de la Vème République, faisant revenir Jacques Chirac à l’Hôtel Matignon, 10 ans après avoir en avoir claqué la porte lors de la présidence VGE.
A présent, la Gauche sortante au pouvoir ne réussira jamais à être reconduite : elle revient en 1988, mais avec une majorité relative, est laminée en 1993, revient en 1997 à la suite de la dissolution ratée de Jacques Chirac, avant de connaitre le traumatisme de 2002, quand Lionel Jospin, alors Premier ministre de cohabitation de Jacques Chirac est éliminé dès le 1er tour, devancé par Jean Marie Le Pen…
La Gauche dite alors « Plurielle » va connaitre une décennie d’opposition, avant de retrouver le pouvoir en 2012, avec François Hollande qui bat Nicolas Sarkozy.
Entre-temps, l’ex-compagne de François Hollande, Ségolène Royal avait affronté Nicolas Sarkozy lors de la Présidentielle de 2007, mais sera battue assez largement avec 47 %.
En 2008, Jean-Luc Mélenchon et plusieurs de ses partisans claquent la porte du PS pour créer le « Parti de Gauche ».
En 2012, ce sera « l’éclaircie » mais pour une courte durée, avec la victoire de François Hollande face à Nicolas Sarkozy. Le Parti socialiste (PS) remporte la présidentielle avec 51 % des suffrages et les législatives, obtenant 280 sièges sur les 328 que comptent la Majorité Présidentielle. Jean Marc Ayrault devient Premier Ministre.
Mais rapidement, tensions internes entre aile réformatrice et aile plus sociale se feront sentir, avec l’émergence d’un « bloc » de « Frondeurs » au sein même du PS.
2014–2017 : marque incontestablement l’ affaiblissement du PS. Jean-Marc Ayrault est remplacé par Manuel Valls mène une ligne sociale-libérale (loi Travail, pacte de responsabilité).
D’où la déception de l’électorat de gauche → montée de la défiance.
Scissions et montée de personnalités comme Jean-Luc Mélenchon (qui fonde La France Insoumise en 2016).
François Hollande et c’est une « première » sous la Vème République annonce qu’il ne se représentera pas. Les raisons principales sont notamment sa crainte de perdre à la future « Primaire » de la Gauche mais également l’émancipation d’Emmanuel Macron, alors Ministre de l’économie et des finances qui annonce sa candidature….
2017 Cinq ans après le triomphe, c’est l’effondrement du PS
Le vainqueur de la Primaire Benoît Hamon (PS) ne recueille que 6 % à la présidentielle.
Jean-Luc Mélenchon (LFI) fait 19,6 % et devient la figure dominante de la gauche radicale.
Emmanuel Macron capte une partie de l’électorat de centre-gauche et l’emporte très largement au 2ème tour face à Marine Le Pen, avec plus de 68 % des suffrages exprimés. Aux législatives, « En Marche » le parti présidentiel obtient 351 sièges, soit la majorité absolue, du jamais vu également pour une formation politique qui n'existait deux ans plus tôt. Le PS passe de 280 à 45 députés !.
2017–2022 : recomposition difficile
PS et EELV cherchent à se reconstruire.
La gauche est très divisée : entre écologistes, socialistes, communistes et insoumis.
Montée en puissance des thématiques écologiques et sociales (climat, inégalités).
2022 : l’expérience NUPES
Alliance électorale entre LFI, PS, EELV, PCF pour les législatives.
Jean-Luc Mélenchon espère être Premier ministre (“Élisez-moi”).
Résultat : la NUPES devient le principal bloc d’opposition, mais reste minoritaire.
Des tensions internes persistent entre LFI et les autres partis.
2022–2024 : divisions et tensions
Les désaccords sur la stratégie européenne, la guerre en Ukraine, le rapport à la République, l’organisation interne de LFI, fragilisent l’unité.
Des départs et repositionnements se multiplient au sein du PS et d’EELV.
2024–2025 : où en est la gauche ?
La gauche reste fragmentée mais cherche à se rassembler pour peser face à la droite et à l’extrême droite.
Les écologistes et une partie du PS tentent d’exister hors de la domination de LFI.
Jean-Luc Mélenchon conserve un poids important, mais son leadership est contesté.